- Home
- Jean M. Auel
Les chasseurs de mammouths Page 54
Les chasseurs de mammouths Read online
Page 54
22
Quatre paires de sabots martelaient à l’unisson la terre durcie.
Couchée sur le garrot de la jument, Ayla plissait les paupières contre le vent glacial qui lui brûlait le visage. Elle chevauchait sans effort, et l’action conjuguée de se genoux et de ses hanches était en parfait accord avec les muscles puissants de sa monture lancée au galop. Elle nota un changement dans le rythme des autres sabots, lança un coup d’œil vers Rapide, Il avait pris de l’avance mais montrait maintenant des signes de fatigue et se laissait distancer. Elle amena la jument à s’immobiliser. Le jeune étalon en fit autant. Enveloppés des nuages de vapeur que dégageait leur respiration haletante, les deux chevaux baissaient la tête. Ils étaient fatigués l’un et l’autre, mais la course avait été belle.
Maintenant bien droite et toujours en harmonie avec l’allure de sa monture, Ayla reprit la direction de la rivière. Elle appréciait de se retrouver au grand air. Il faisait froid, mais le temps était magnifique : l’éclat d’un soleil incandescent était encore accentué par la glace étincelante et la blancheur laissée par un récent blizzard.
A peine sortie de l’abri, ce matin-là, Ayla avait décidé d’emmener les chevaux pour une longue course. L’air lui-même l’y engageait : il semblait plus léger, comme si un pesant fardeau s’était dissipé. Le froid semblait moins intense, bien que rien n’eût visiblement changé. La glace était toujours aussi solide, la neige toujours poussée par le vent en minuscules projectiles.
Elle avait décelé de subtiles différences. La température s’était élevée, le vent soufflait avec moins de violence. On aurait pu parler d’intuition, d’impression, mais il s’agissait en réalité d’une sensibilité aiguë. Pour des gens qui vivaient sous des climats où régnait un froid extrême, la plus infime différence dans la rigueur des conditions atmosphériques attirait l’attention et se voyait souvent accueillie par un déploiement d’exubérance. Ce n’était pas encore le printemps, mais l’impitoyable étreinte d’un froid accablant s’était un peu desserrée. Ce réchauffement presque imperceptible apportait avec lui l’assurance que la vie allait renaître.
Ayla sourit en voyant le jeune étalon partir en caracolant, l’encolure fièrement arquée, la queue toute droite. Elle considérait encore Rapide comme le petit qu’elle avait aidé à mettre au monde, mais ce n’était plus un jeune poulain. S’il n’avait pas encore atteint son poids adulte, il était déjà plus grand que sa mère, et c’était un véritable cheval de course. Il aimait courir, il filait comme le vent. Pourtant, il existait une différence entre les chevaux. Sur une courte distance, Rapide courait invariablement plus vite que sa mère, il la distançait aisément dès le départ. Mais Whinney avait plus d’endurance. Elle pouvait galoper plus longtemps et, sur un long parcours elle rattrapait invariablement son fils, le dépassait et poursuivait sa course à la même allure régulière.
Ayla mit pied à terre mais s’immobilisa un instant avant d’écarter le rabat pour entrer dans l’habitation. Il lui était fréquemment arrivé d’utiliser les chevaux comme prétexte pour s’échapper, mais ce matin là, elle avait constaté avec un soulagement particulier que le temps se prêtait à une longue course. Certes, elle était heureuse d’avoir retrouvé un groupe humain, d’y avoir été accueillie, de pouvoir participer à ses activités, mais il lui arrivait d’éprouver le besoin d’être seule. C’était surtout vrai quand certaines incertitudes, certains malentendus qui n’avaient pas trouvé de solution accentuaient les tensions.
Depuis quelque temps, Fralie passait une grande partie de son temps au Foyer du Mammouth, avec les jeunes gens et les jeunes filles du Camp, au grand désespoir de Frébec. Ayla avait surpris, en provenance du Foyer de la Grue, des discussions ou plutôt des diatribes de Frébec qui se plaignait de l’absence de Fralie. Il n’aimait pas, elle le savait, voir sa compagne se lier trop étroitement avec elle et elle était sûre que la jeune femme enceinte, pour avoir la paix, se tiendrait davantage à l’écart. Cela inquiétait Ayla, d’autant que Fralie lui avait récemment confié qu’elle avait uriné du sang. Ayla l’avait informée qu’elle risquait de perdre son enfant si elle ne se reposait pas. Elle lui avait promis un remède, mais il allait être maintenant plus difficile de la traiter si Frébec surveillait tout de son air désapprobateur.
Outre cette inquiétude, planait l’indécision d’Ayla à propos de Jondalar et de Ranec. Jondalar, depuis quelques jours, semblait redevenir lui-même. Mamut lui avait demandé de venir le voir au sujet d’un instrument particulier dont il avait eu l’idée, mais, le jour en question, le chaman avait été très occupé : c’était seulement vers le soir, à l’heure où, généralement, les jeunes gens se réunissaient au Foyer du Mammouth, qu’il avait eu le temps de parler de son projet. Les deux hommes s’étaient installés dans un coin tranquille, entourés par les rires et les plaisanteries habituels.
Ranec était plus attentionné que jamais. Depuis quelque temps, sous couvert de badinage, il pressait Ayla de revenir partager son lit. Elle éprouvait encore quelques difficultés à refuser tout de go : on lui avait trop fortement inculqué l’obéissance aux désirs d’un homme pour qu’elle pût s’en débarrasser facilement. Elle riait de ses saillies – elle comprenait de mieux en mieux l’humour et même les intentions plus sérieuses qu’il masquait parfois – mais elle éludait habilement ses invitations tacites, ce qui déclenchait une hilarité générale aux dépens de Ranec. Il riait, lui aussi, comme s’il prenait plaisir à ses répliques spirituelles, et elle était attirée par son attitude amicale. Elle se sentait à l’aise en sa compagnie.
Mamut remarqua le sourire de Jondalar et hocha la tête d’un air approbateur. Le tailleur de silex avait évité la réunion des jeunes, il les avait observés de loin, et les rires n’avaient fait qu’exaspérer sa jalousie. Il ignorait que ces rires étaient souvent déclenchés par le refus qu’opposait Ayla aux propositions de Ranec, Mamut, lui le savait.
Le lendemain, pour la première fois depuis trop longtemps, Jondalar sourit à la jeune femme. Elle sentit son souffle s’étrangler dans sa gorge, son cœur accéléra ses battements. Durant les quelques jours qui suivirent, il se mit à revenir plus tôt au foyer, sans toujours attendre qu’elle fût endormie. Elle n’osait pas s’imposer à lui, et il paraissait hésiter encore à l’approcher, mais elle se prenait à espérer qu’il commençait à surmonter ce qui l’avait tourmenté. Pourtant, elle avait peur de se laisser aller à cet espoir...
Ayla reprit longuement son souffle, écarta le lourd rabat et le retint pour livrer passage aux chevaux. Après avoir secoué sa pelisse et l’avoir accrochée à une cheville, elle pénétra dans l’habitation. Pour une fois, le Foyer du Mammouth était presque désert. Jondalar et Mamut s’y trouvaient seuls, en grande conversation. La jeune femme fut heureuse, mais surprise, de voir son compagnon et, du coup, prit conscience qu’elle l’avait très peu vu, ces derniers temps. Elle sourit, se hâta vers les deux hommes, mais la grimace renfrognée de Jondalar effaça son sourire. Il ne semblait pas heureux de son arrivée.
— Tu es restée dehors toute la matinée seule ! Lâcha-t-il. Ne sais-tu pas qu’il est dangereux de sortir seule ? Tu inquiètes tout le monde. Bientôt quelqu’un aurait dû partir à ta recherche.
Il ne disait pas que cette inquiétude avait été la sienne, que c’était lui qui avait été sur le point de se mettre à sa recherche.
Devant cette véhémence, Ayla recula.
— Je n’étais pas seule. J’étais avec Whinney et Rapide. Je les ai emmenés courir un peu. Ils en avaient besoin.
— Eh bien, tu n’aurais pas dû sortir par ce froid. Il est dangereux de sortir seule, répéta-t-il sans grande conviction.
En même temps, il lançait un coup d’œil à Mamut, dans l’espoir d’obtenir son appui.
— Je t’ai dit que je n’étais pas seule. J’étais avec les chevaux. Et il fait beau, dehors : il y a du soleil, et il fait moins froid.
La colère de Jondalar agaçait Ayla. Elle ne comprenait pas que cette colère dissimu
lait une peur presque intolérable pour sa sécurité.
— Il m’est déjà arrivé de sortir seule en hiver, Jondalar. Qui m’accompagnait, à ton avis, quand je vivais dans ma vallée ?
Elle a raison, pensait-il. Je ne devrais pas m’obstiner à vouloir lui dire quand elle peut sortir et où elle peut aller. Mamut n’a pas paru trop soucieux quand il m’a demandé où était Ayla, et elle est la fille de son Foyer. J’aurais dû me fier davantage au vieux chaman, se disait Jondalar. Il se sentait stupide, comme s’il avait fait une scène pour rien.
— Bon... peut-être devrais-je aller voir comment vont les chevaux, marmonna-t-il.
Il battit en retraite, se hâta vers le foyer des chevaux.
Ayla le suivait des yeux. Pensait-il donc qu’elle ne se souciait pas des animaux ? se demandait-elle. Elle se sentait déconcertée, bouleversée. Il devenait impossible, semblait-il de comprendre Jondalar.
Mamut observait ses réactions. Sa souffrance, sa détresse étaient claires. Pourquoi les êtres avaient-ils tant de mal à cerner leurs problèmes ? Il avait envie de les mettre face à face, afin de les obliger à voir ce qui paraissait l’évidence pour tous ceux qui les entouraient, mais il résista à cette impulsion. Il avait déjà fait tout ce qu’il pensait pouvoir faire. Dès le début, il avait perçu chez l’homme de Zelandonii une tension sous-jacente et il était convaincu que l’obstacle était moins évident qu’il n’y semblait. Mieux valait les laisser trouver eux-mêmes la solution. Toutefois, il pouvait encourager Ayla à lui parler des difficultés ou, au moins, l’aider à découvrir les choix qui se présentaient à elle, à reconnaître ses propres désirs, ses propres possibilités.
— Tu as bien dit qu’il faisait moins froid dehors, Ayla ? demanda Mamut.
La question mit un certain temps à pénétrer l’enchevêtrement des pensées qui la tourmentaient.
— Quoi ? ... Oh... oui, je pense. On n’a pas vraiment l’impression qu’il fasse plus chaud. On croit simplement sentir un froid moins pénétrant.
— Je me demandais quand Elle allait briser l’échine de l’hiver, dit Mamut. Il me semblait que le jour n’était pas loin.
— « Briser l’échine » ? Je ne comprends pas.
— C’est une expression, Ayla. Assieds-toi. Je vais te conter une histoire d’hiver à propos de la Grande et Généreuse Terre Mère qui a créé tout ce qui vit, poursuivit le vieil homme en souriant.
Ayla s’installa à côté de lui, sur une natte placée près du feu.
— Au cours d’une lutte acharnée, la Terre Mère a arraché une force de vie au Chaos, qui est un néant froid et immobile, comme la mort. A l’aide de cette force, Elle a créé la vie et la chaleur, mais Elle doit sans cesse se battre pour la vie qu’Elle a créée. Quand arrive la saison froide, nous savons que la lutte a commencé entre la Généreuse Terre Mère, qui désire faire naître une vie pleine de chaleur, et la froide mort du Chaos. Mais Elle doit d’abord prendre soin de Ses enfants.
Ayla commençait maintenant à s’intéresser à l’histoire. Elle adressa à Mamut un sourire d’encouragement.
— Que fait-Elle, pour prendre soin de Ses enfants ?
— Elle en plonge quelques-uns dans le sommeil. Elle en habille chaudement certains pour leur permettre de résister au froid. Elle engage certains autres à faire des provisions et à se cacher. Au plus fort de la saison froide, quand la Mère est engagée dans la bataille de la vie et de la mort, rien ne bouge, rien ne change, tout semble mort. Pour nous, sans un endroit chaud où vivre et de quoi manger dans nos réserves, la mort en hiver, gagnerait la bataille. C’est ce qui arrive, parfois, si la lutte se prolonge indûment. En cette saison, personne ne sort beaucoup. Les gens se livrent à des travaux, ils se racontent des histoires, ils bavardent, mais ils ne bougent pas beaucoup et ils dorment davantage. Voilà pourquoi on appelle l’hiver la petite mort.
« Finalement, quand le froid a repoussé la Mère aussi loin qu’Elle veut aller, Elle résiste. Elle fait tous ses efforts, encore et encore, jusqu’au moment où Elle brise l’échine de l’hiver. Sa victoire signifie que le printemps va revenir, mais ce n’est pas encore le printemps. Elle a livré une longue bataille et Elle a besoin de repos avant de pouvoir faire renaître la vie. Mais on sait qu’Elle a gagné. On respire l’odeur de Sa victoire, on la sent dans l’air.
— C’est vrai ! Je l’ai sentie, Mamut ! Voilà pourquoi j’étais obligée de sortir avec les chevaux. La Mère a brisé l’échine de l’hiver ! s’écria Ayla.
L’histoire expliquait précisément ce qu’elle avait ressenti.
— Je pense que le moment est venu de faire une fête, ne crois-tu pas ?
— Oh oui, je le crois !
— Peut-être accepterais-tu de m’aider à l’organiser ?
Mamut attendit tout juste le hochement de tête de la jeune femme.
— Tout le monde ne perçoit pas encore Sa victoire, mais cela ne tardera plus. Nous pouvons tous deux en attendre les signes et décider ensuite du moment.
— Quels signes ?
— Quand la vie commence à se réveiller, chacun le sent à sa façon. Certains sont heureux, ils ont envie de sortir, mais il fait encore trop froid pour rester bien longtemps dehors : alors, ils deviennent nerveux, irritables. Ils voudraient saluer les frémissements de vie qu’ils perçoivent en eux, mais bien des tempêtes sont encore à venir. En cette période de l’année, l’hiver sait que tout est perdu. Il est furieux, les gens le sentent, ils deviennent furieux, eux aussi. C’est entre maintenant et le printemps qu’ils sont le plus nerveux. Tu t’en rendras compte, je pense. C’est aussi le moment où une fête est tout indiquée. Elle fournit aux gens une bonne raison d’exprimer la joie plutôt que la colère.
Je savais qu’elle comprendrait, pensait Mamut en regardant Ayla froncer les sourcils. C’est à peine si j’ai commencé de percevoir la différence, et elle, elle l’avait déjà sentie. Je savais qu’elle était douée, mais ses possibilités ne cessent de m’étonner, et sans doute n’en ai-je pas encore découvert toute la portée. Peut-être ne le saurai-je jamais, mais ses dons pourraient bien dépasser les miens de très loin. Qu’a-t-elle dit, à propos de cette racine et de la cérémonie avec les mog-ur ? J’aimerais la préparer... La cérémonie de la chasse, avec le Clan ! Elle m’a transformé, les effets en ont été profonds. Elle aussi a connu une expérience semblable... Est-ce cela qui l’a transformée ? Qui a développé ses tendances naturelles ? Je me demande... La fête du printemps... est-ce trop tôt pour faire reparaître la racine ? Peut-être devrais-je attendre qu’elle ait travaillé avec moi à la Célébration de l’Echine Brisée ? ... Ou la prochaine occasion... Il y en aura d’autres entre maintenant et le printemps...
Deegie, chaudement vêtue pour sortir, s’engagea dans le passage central vers le Foyer du Mammouth.
— J’espérais te trouver ici, Ayla. Je veux aller vérifier les pièges que j’ai posés pour essayer d’attraper des renards blancs qui me serviront à garnir la pelisse de Branag. Tu viens avec moi ?
Ayla, à peine réveillée, leva les yeux vers le trou à fumée, en partie découvert.
— Il a l’air de faire beau, dehors. Donne-moi le temps de m’habiller. Elle repoussa les couvertures, se redressa. Après s’être étirée, avoir bâillé, elle alla vers le réduit protégé par une tenture près du foyer des chevaux. En chemin, elle passa devant une plate-forme de couchage où dormaient une demi-douzaine d’enfants, étalés les uns sur les autres comme une nichée de louveteaux. Elle vit les grands yeux bruns de Rydag ouverts, lui sourit. Il referma les paupières, se blottit entre la plus petite, Nuvie, et Rugie, qui aurait bientôt huit ans. Crisavec, Brinan et Tusie faisaient, eux aussi, partie de la masse indistincte. Ayla, récemment, avait vu le petit dernier de Fralie, Tasher, qui n’avait pas encore trois ans, commencer à s’intéresser aux autres enfants. Latie, elle, proche de l’âge adulte, jouait le moins souvent avec eux.
Les enfants étaient gâtés. Ils pouvaient se nourrir et dormir là et quand ils le voulaient. Ils respectaient rarement les obser
vances territoriales de leurs aînés : l’abri tout entier leur appartenait. Ils avaient le droit de réclamer l’attention des membres adultes du Camp, et leurs exigences étaient souvent accueillies comme une intéressante diversion : personne n’était particulièrement pressé, personne n’avait nulle part où aller. Partout où leur curiosité amenait les enfants, un membre plus âgé du groupe se trouvait là, pour leur prodiguer son assistance, ses explications. S’ils voulaient coudre des peaux, on leur fournissait les outils, des morceaux de cuir, des filaments de nerf. S’ils voulaient façonner des outils de pierre, on leur donnait des silex, des marteaux de pierre ou d’os.
Ils se livraient aux joies de la lutte, se bousculaient, inventaient des jeux qui, souvent, imitaient les activités de leurs aînés. Ils creusaient leurs propres petits foyers, apprenaient à se servir du feu. Ils faisaient semblant de chasser, transperçaient des morceaux de viande tirés des réserves, les faisaient cuire. Quand, en jouant au « foyer », ils imitaient les activités sexuelles des adultes, ceux-ci souriaient avec indulgence. Aucune manifestation de la vie quotidienne n’était distinguée comme devant être cachée ou réprimée. Chaque aspect représentait une instruction nécessaire dans l’évolution vers l’âge adulte. Le seul tabou était la violence, surtout si elle était excessive ou gratuite.
A vivre dans une si étroite promiscuité, ces gens avaient appris que rien ne pouvait plus rapidement détruire un Camp ou un peuple que la violence, surtout lorsqu’ils devaient demeurer enfermés durant les longs et froids hivers. Que ce fût par hasard ou à dessein, chaque coutume, chaque manière de faire, chaque convention, chaque pratique, même si elle n’était pas directement liée à la violence, tendait à la maintenir à un degré minimal. Les règles de conduite acceptées autorisaient un large éventail d’activités individuelles différentes qui, généralement, ne conduisaient pas à la violence ou qui pouvaient être considérées comme des issues acceptables pour un trop plein d’émotions. On favorisait les talents personnels. On encourageait la tolérance, alors que, tout en les comprenant, on bannissait l’envie, la jalousie. Les compétitions, y compris les discussions, étaient largement utilisées comme solutions de rechange, mais elles étaient sévèrement contrôlées, ritualisées, maintenues dans des limites bien définies. Les enfants apprenaient rapidement les règles fondamentales. Crier était toléré, frapper ne l’était pas.

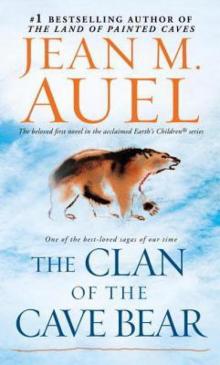 The Clan of the Cave Bear
The Clan of the Cave Bear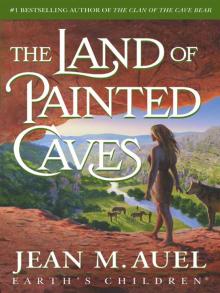 The Land of Painted Caves
The Land of Painted Caves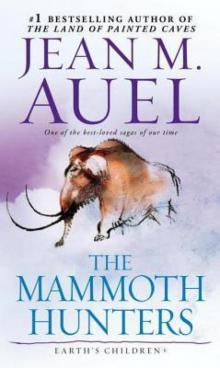 The Mammoth Hunters
The Mammoth Hunters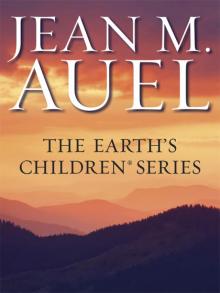 The Earth's Children Series 6-Book Bundle
The Earth's Children Series 6-Book Bundle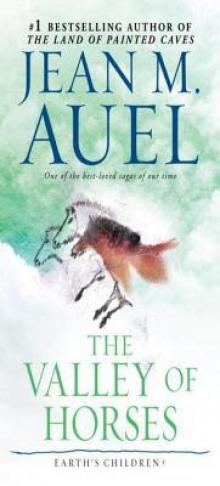 The Valley of Horses
The Valley of Horses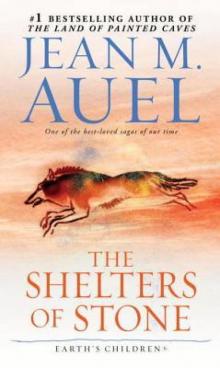 The Shelters of Stone
The Shelters of Stone The Clan of the Cave Bear ec-1
The Clan of the Cave Bear ec-1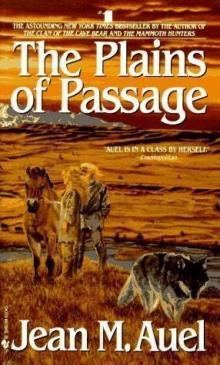 THE PLAINS OF PASSAGE ec-4
THE PLAINS OF PASSAGE ec-4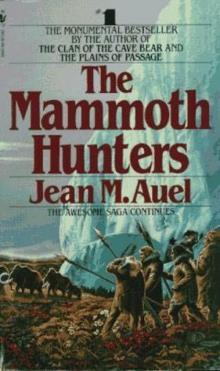 The Mammoth Hunters ec-3
The Mammoth Hunters ec-3 THE SHELTERS OF STONE ec-5
THE SHELTERS OF STONE ec-5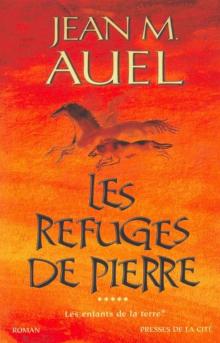 Les refuges de pierre
Les refuges de pierre![Earth's Children [02] The Valley of Horses Read online](http://i1.bookreadfree.com/i1/03/30/earths_children_02_the_valley_of_horses_preview.jpg) Earth's Children [02] The Valley of Horses
Earth's Children [02] The Valley of Horses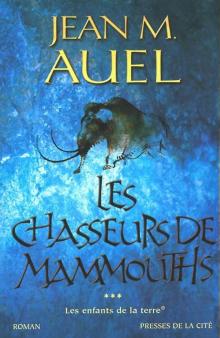 Les chasseurs de mammouths
Les chasseurs de mammouths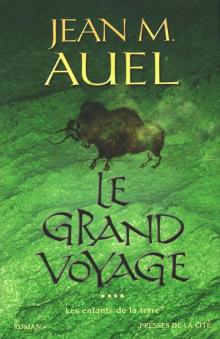 LE GRAND VOYAGE
LE GRAND VOYAGE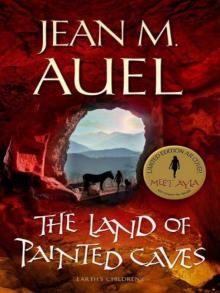 The Land of Painted Caves ec-6
The Land of Painted Caves ec-6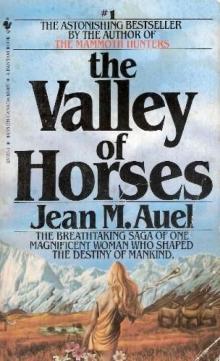 The Valley Of Horses ec-2
The Valley Of Horses ec-2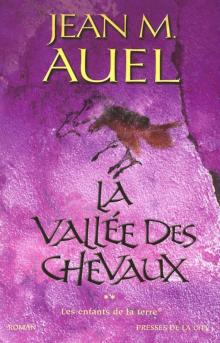 La Vallée des chevaux
La Vallée des chevaux